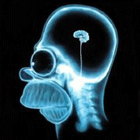 Bon, comme d’habitude, l’épreuve de philo est un terrible galimatias de confusions de rationalités. Essayons d’y mettre un ordre que les barbiquets de l’ÉduNat seraient bien incapables d’y mettre.
Bon, comme d’habitude, l’épreuve de philo est un terrible galimatias de confusions de rationalités. Essayons d’y mettre un ordre que les barbiquets de l’ÉduNat seraient bien incapables d’y mettre.
Série L – coefficient 7
Deux sujets de dissertation ont été proposés aux élèves de la série L : « Le langage n’est-il qu’un outil ? » et « La science se limite-t-elle à constater les faits ? »
Sur le langage, d’abord. Le sujet tel qu’il est formulé témoigne d’une confusion malheureusement trop répandue entre le Signe et l’Outil. La faute en incombe à tous ceux : philosophes, linguistes, communicologues, qui croient que le langage est un « outil » de communication.
Examinons d’abord cette confusion. « Communication » n’est pas « transmission ». Étymologiquement, dans « communication » il y a « munus », c’est-à-dire : service et, en prenant le second sens attesté dans le dictionnaire de Gaffiot, mise en commun d’intérêts ou plus exactement réalisation commune d’un service. Ce qui signifie que la communication n’est pas de l’ordre du langage, mais une convergence sociologique négociée qui permet les échanges dans un cadre implicitement -et souvent explicitement- contractuel (voir un ouvrage intitulé « L’Usage, le Contrat et le Service », ISBN 978-2-8106218-2-8, disponible chez Amazon) permettant les échanges. La communication est donc un rapport social et n’a rien à voir avec le langage : l’aphasique a perdu le langage et communique toujours dans le soin avec son thérapeute, alors que le paranoïaque peut être un maître ès langage mais n’entre jamais dans une relation thérapeutique. Les échanges sont de trois ordres : des valeurs (l’économique), du travail (la sympractique) et des mots (l’interlocution), mais ce sont là des contenus et non des processus.
On voit où se situe l’illusion : on a privilégié l’interlocution, en oubliant qu’elle n’est qu’une conséquence de la communication. C’est une mise en partage négociée des mots, mais encore faut-il être pour cela capable de négocier… et de se traduire. Je ne développerai pas plus, car la démonstration serait trop longue. Bornons-nous à noter que le langage ne nous apparaît jamais en tant que tel, mais toujours sous les espèces des langues, c’est-à-dire des mots et syntaxes négociés, acceptés par des groupes. Et, dès lors, apparaît la barrière linguistique ! Curieux « outil » de « communication » que le langage qui fait qu’en deçà et au-delà d’une frontière linguistique on ne se comprend plus ! L’Humain ne parle jamais « homme » mais Français, Anglais, Allemand etc…
On doit donc séparer complètement le langage de la communication et la communication de la transmission. Le pire, dans la poursuite de l’illusion, est de considérer le langage comme un « outil ». L’outil relève d’une rationalité spécifique qui nous fait homo faber quand le langage nous fait homo sapiens. L’analyse technique n’est pas l’analyse logique et n’a rien cependant à lui envier. L’outil nous vêt, nous fait faire de l’habitat, nous permet d’outrepasser les limites physiques de nos sens (industries déictiques, comme la radio, la RMN etc…) et de notre force (industries dynamiques, dont un bel exemple est le moteur, ou le vérin etc…). Il est normal, alors, qu’il permette d’outrepasser la « proxémique » et d’envoyer à distance des vecteurs écrits ou sonores qui ne sont pas pour autant des « messages », tant il est vrai que le message ne se confond pas avec son vecteur et demeure toujours le produit d’une analyse proprement humaine, qu’aucune machine n’est en mesure d’opérer. Même s’il existe industriellement une différence perceptible entre le casse-noix et l’ordinateur, ils relèvent tous deux d’une même analyse en Outil. L’atechnique ne peut analyser ni l’un ni l’autre.
Si l’on peut à la rigueur dire que la « tâche » est le quoi faire, et que la « machine » est vaguement le « que faire », il n’en reste pas moins vrai que le « matériau » n’est pas la matière brute, mais la matière correspondant à des tâches (le cuivre à la conduction ou à la production de bruit), et que « l’engin » constitue du dispositif asservi à une « machine », par exemple le lieur de la botteleuse, il n’en demeure pas moins que toutes ces distinctions relèvent d’une analyse culturelle spécifique de ce qui matériellement s’offre à nous dans la nature, fût-ce cela révélé par la science. Bref : nous avons l’Outil, là où l’animal n’a que l’instrument, c’est-à-dire une relation immédiate de la fin et du moyen. Chez nous, c’est l’Outil, c’est-à-dire une analyse technique de la fin et du moyen.
Alors le langage, là dedans ? Eh bien ce n’est pas le produit d’une analyse technique, mais très exactement une rationalité fondamentale de l’humain, comme l’outil. On ne « fabrique » pas le langage, pas plus qu’on ne « fabrique » du message. Le langage n’est PAS un outil, et il faut être idiot pour imaginer le contraire. Mais qu’est-ce que c’est ?
Il faut partir du rapport du vivant au monde. Une première analyse s’opère, comme une mise en ordre du chaos des sensations (esthésie) par la gnosie ; cela donne des figures naturelles de représentation, Gestalten pour ne pas employer la traduction aberrante de « formes », dans la mesure où à la fois ça se met en forme et où l’animal sait plus ou moins ce que c’est (notion). Nous obéissons, selon notre nature, à la Gestaltung. Mais notre rapport au monde n’est pas celui du ragondin ou du coyote : la Gestalt est niée, à la représentation naturelle immédiate se substitue une représentation culturelle, médiatisée par l’analyse en Signe. Les fondements de cette analyse ont été exposés depuis Saussure, Cours de Linguistique Générale, II, chapitre IV, théorie de la valeur. Il est étrange qu’on l’ait oublié, à moins que les successeurs de Saussure aient été des imbéciles, hypothèse somme toute fort vraisemblable. Cette représentation culturelle, c’est le Signe, qui nie à la fois le bruit et la notion, et y substitue le Signifiant et le Signifié, et qui substitue à la Gestalt le CONCEPT.
C’est cela, le langage, non point un « outil » inventé pour vivre en société, comme le croyaient naïvement Bühler et les pré-saussuriens (et même, hélas, dans certains passages contraires à sa propre découverte, Saussure lui-même) mais simplement une des formes de notre rapport au monde, rapport conceptuel. Par le langage, le monde nous est « re-présenté ». Le rapport des mots se substitue au rapport immédiat des choses. Mais c’est fondamental !
Ce qui fait en fin de compte, que le langage n’est en aucun cas un « outil », et qu’il n’a pas en fait de « fonction » : il est simplement l’un des quatre modes d’être au monde, celui qui permet de faire du concept, de « dire » le monde, c’est-à-dire de mettre l’ordre de la logique dans le chaos.
Enfin… Quand je dis « chaos », c’est peut-être exagéré, mais l’ordre que nous mettons dans le monde n’est certes jamais celui du « réel ». Car celui-ci est inconnaissable si justement nous ne parvenons pas à mettre des mots dessus. Lacan, à la suite de beaucoup d’autres, l’a dit. Et cela nous conduit au second sujet, tout aussi idiot que le premier : « La science se limite-t-elle à constater les faits ? »
Là, on retrouve l’empirisme face à la science. Bon Dieu ! Mais qu’est-ce qu’un « fait » ? Qu’est-ce qu’une « donnée » ? Que l’on s’y prenne comme on voudra, il n’y a ni « faits » ni « données ». Saussure (toujours lui) avait remarqué ceci : que loin de s’imposer, l’objet dépendait de la manière dont on l’abordait, c’est-à-dire du point de vue de l’observateur. Ce qui veut dire : il y a toujours une logique sous-jacente à l’œuvre, et ce qui est observé est nécessairement CONSTRUIT.
Mais l’empirisme est naïf : il voit le phénomène global. Or le phénomène échappe à ce que Bachelard appelait « l’expérience primitive » qui le voit dans sa globalité, sans le rattacher à aucune causation – ou en le rattachant à des causations fausses. Pour reprendre un exemple de Saussure : « NU », qu’est-ce que c’est ? L’idiot dira « à poil ». Si on l’examine du point de vue du glossologue, ce sont deux phonèmes [n] et [y] qui n’existent que par leur opposition à d’autres phonèmes comme [a], [f] etc… et en même temps un signifiant parce qu’il est déterminé par un signifié précis. Pour l’ergologue, c’est de l’écriture, en majucules, qui s’oppose à « nu », par exemple. Pour le sociologue, « nu » s’oppose à « naked » ou à « nudus » ou « nackt » : cela en fait un mot français. Pour l’axiologue, cela peut marquer une licence dans l’habillement etc… Il en irait de même de n’importe quoi : l’eau n’est jamais pour le scientifique ce qu’elle est pour nous. H2O n’existe que dans le domaine du chimiste, nous buvons de l’eau et lavons avec celle-ci, et non pas avec la représentation H2O, comme molécule parmi les molécules, mais pour le physicien c’est un fluide avec une certaine viscosité, une certaine fluidité, répondant au principe d’Archimède etc…
Ce qui veut dire : Il n’y a ni fait ni donné, mais très exactement du construit. Donc l’intitulé du sujet est idiot. L’empirisme, attaché au phénomène dans sa globalité, ne parvient pas à saisir ce qui, dans une interaction de causalités multiples, relève d’une loi de causalité rationnelle. Donc la science ne constate JAMAIS des faits, mais toujours quelque que chose de construit. Le lapin de Claude Bernard ne produit de l’urine acide que parce qu’il a eu un régime carnivore et non pas herbivore : on en déduit le rôle des graisses stockées dans l’organisme quand on crève de faim. C’est donc en NIANT le fait, en allant au-delà de celui-ci, que l’on peut faire de la science.
Que « constate » donc la science ? Rien d’autre que ce qu’une théorisation préalable (pour certains, une « grille de lecture ») a prévu, et qui guide l’observation. Cette théorisation peut être très explicite voire implicite, mais elle est là, qui fait rechercher dans la diffraction du phénomène ce qui relève des causations que l’on recherche, et fait négliger les autres causations ne relevant pas de ce qui est recherché. On aura beau évoquer la « sérendipité », rien ne se découvre par hasard, et François Jacob, dans on ouvrage « La Logique du Vivant » montrait qu’une observations ne prenait sens que dans le cadre d’une théorie prête à l’intégrer. Témoin, par exemple, la cellule, observée depuis le XVIIe siècle, mais qui n’a pris sens qu’au XIXe siècle dans le cadre d’une théorie du vivant. Idem les lois de Mendel qui n’ont pris sens que dans le cadre d’une théorie de la reproduction des caractères : la génétique.
Bref : l’énoncé du sujet met les candidats sur de fausses pistes, et je doute que les profs de philo en aient conscience.
Série ES – coefficient 4
Les élèves de la série ES ont eu à choisir entre les dissertations : « Que devons-nous à l’Etat ? » et « Interprète-t-on à défaut de connaître ? »
Le premier sujet est en or ! Redde Caesari quae sunt caesaris ! Je ne doute aucunement que les profs attendaient des louages à l’État, c’est-à-dire à ce qu’il est actuellement. Mais il faut préciser anthropologiquement la notion d’état. D’abord, l’état, privé de sa majuscule : c’est le jugement que l’on porte sur la configuration historique d’une société, obtenue par le jeu des contrats sociaux, incluant la délégation du pouvoir d’œuvrer pour autrui intrinsèque à toute personne, ou plus exactement à tout citoyen (= celui qui est considéré comme membre de la Cité et qui, à ce titre, à voix au chapitre). Cela fait un état, et le jugement de valeur que l’on porte dessus est l’équité : cela nous satisfait ou ne nous satisfait pas. Telle est la base de l’état.
Rendons-lui maintenant la majuscule (qu’il la mérite ou non). Il s’agit cette fois d’une superstructure, c’est-à-dire d’une organisation de la délégation du pouvoir civique, dont le rôle, ainsi que le soulignaient Bastiat et Tocqueville (mais quels bacheliers les ont lus ???) est d’assurer collectivement la défense des citoyens contre les agressions extérieures (guerre) et intérieures (crimes et délits) mettant en danger le groupe dans son ensemble et les particuliers. L’État est donc, basiquement, un pouvoir collectif consenti par contrat. Il devient alors évident qu’il doit aussi négocier avec d’autres groupes (diplomatie) et se donner les moyens financiers d’exercer son rôle (fiscalité). Et qu’il doit être contrôlé de manière à ne pas outrapasser sa mission.Tant que cet aspect contractuel est respecté par ceux qui ont reçu délégation, il n’y a pas de raison de ne pas rendre à César ce qui appartient à César : dans le contrat, si l’État a fait quelque chose pour nous, il est normal que d’une manière ou d’une autre nous le lui rendions, par la corvée ou par la fiscalité. Car c’est toujours NOTRE contribution au social qui est en jeu. On demeure là dans un système équitable.
Maintenant, et c’est ce qui fait le corps de l’argumentation de La Loi selon Bastiat, l’État peut malheureusement, dans le cadre d’une idéologie de l’égalité mal comprise et donc de la redistribution, devenir un moyen de spoliation. L’État devient alors la superstructure organisatrice de l’économie prise dans son pire sens, celui de la redistribution de la propriété. Laquelle propriété est composante intégrale de la Personne. Cette redistribution profite tantôt aux uns, tantôt aux autres. Par exemple, on peut subventionner tel ou tel secteur de l’activité industrielle, instaurer des mesures protectionnistes, financées, en dernières analyse, par ceux qui en pâtissent, ne serait-ce que par l’augmentation indue des coûts de production et de vente lorsque la même denrée serait moins dispendieuse venue de l’extérieur. Ou l’on peut choisir de subventionner, sous couvert d’égalité, des personnes sans emploi et peu désireuses d’en trouver un quelconque, des personnes sans qualification leur permettant d’exercer une industrie utile, etc… L’État, même si nous n’avons pas d’enfants solarisés, par exemple, nous contraint à payer pour scolariser les enfants des autres. A payer pour la santé des autres si nous ne sommes pas malades nous-mêmes. Bref : l’État oblige les citoyens à une solidarité excessive, obligatoire, qui n’est en fait rien d’autre qu’une spoliation. L’autre conséquence est de mettre l’assisté en position de non-personne, puisqu’il ne contribue pas à la Cité. L’État fabrique des sous-citoyens.
Il suffit de constater que 52% du PIB est confisqué par l’État pour opérer cette redistribution : le citoyen est spolié d’une grande partie des résultats de son activité, et une minorité d’actifs fait vivre une majorité lourde d’inactifs ou de peu actifs. Dans le même temps, l’État -c’est constatable- n’assure plus la sécurité intérieure, et la part ridicule du budget alloué à la Défense ne lui permet plus d’opérer dans l’un de ses trois rôles régaliens. Nous ne rendons pas à César le service qu’il nous rend, César nous spolie.
Dans cette configuration, qui est celle de maintenant : favoritisme monopolistique et redistribution, le tout par moyens de spoliation, non seulement nous ne devons que très peu à l’État, mais encore devrions-nous nous en débarrasser. C’est à César de nous rendre ce qu’il nous a pris.
Voilà qui est vrai, mais qui me vaudrait une très mauvaise note de la part des barbiquets de l’ÉduNat. J’aimerais pourtant que bon nombre de candidats le disent !
Interpréter à défaut de connaître ! Voilà bien encore un sacré embrouillamini ! D’abord qu’est-ce que connaître ? C’est se représenter logiquement par le biais du langage. Mais cette connaissance, si elle n’est pas étayée par l’expérimentation (et non par l’expérience) demeure formelle. Elle est à cette aune formelle purement mythique, car le mythe n’est jamais dépourvu de logique, puisque ce n’est rien d’autre qu’une visée du langage, à côté de la science et de la poétique. Au lieu de se substituer à l’ordre des choses, l’ordre des mots le fait exister indépendamment de l’ordre propre des choses.
Mais pourquoi opposer interpréter et connaître ? Admettons qu’en matière politique, et en regard des excès médiatiques, l’interprétation idéologique tienne lieu de connaissance, et se donne pour telle. Inutile de souligner les excès de cette posture, ils sont connus de tous ceux qui ne s’en laissent pas conter. En dehors de ce cas extrême, interpréter et connaître ne s’opposent pas nécessairement. Scientifiquement, la connaissance, si c’est la substitution conceptuelle de l’ordre des mots à l’ordre des choses, n’est qu’une interprétation logique de l’ordre du monde, mais, encore une fois, soumise à validation expérimentale. Les phénomènes de gravitation sont diversement interprétés par la physique newtonienne et par la Relativité. Deux modèles interprètent logiquement le cosmos, et chacun d’eux est connaissance, dans son champ propre.
Autrement dit, il existe plusieurs interprétations : idéologique (sociologique aussi), logique, mais aussi, il ne faudrait pas l’oublier, axiologique. « Ne trouvez-vous pas qu’il fait un peu chaud ici ? » ne dit rien de plus que ce qui est prédiqué et énoncé. Mais on peut l’interpréter comme un ordre ou une invite à ouvrir la fenêtre ! Et là nous sommes encore dans une autre acception de l’interprétation : on décode le « non-dit » sous le « dit ». C’est peut-être (là, je serai plus réservé que précédemment) une « connaissance » logique d’un vouloir-dire qui se reformule en « Ouvrez la fenêtre ! ». L’interprétation est alors guidée par des considérations axiologiques (retenue, restriction du dire, euphémie…) et des considérations sociologiques. On voit que ce n’est pas le même statut que la connaissance précédente.
Série S – coefficient 3
Les deux dissertations proposées sont : « Peut-on agir moralement sans s’intéresser à la politique ? » et « Le travail permet-il de prendre conscience de soi ? »
Bah ! LE politique (et non la politique) et la morale n’ont pas la même origine rationnelle. Le premier est d’ordre sociologique, le second d’ordre axiologique. En somme, le Droit est hors la Loi. Ce qui veut dire : ce qui nous fait homo politicus n’est pas ce qui nous fait homo ethicus.
Mais une rationalité peut être reprise par une autre : le contrat social peut faire l’objet de deux « jugements », l’un de simple valeur, c’est l’équité, l’autre réellement médiatisé, c’est la légitimité. De même l’éthique peut être conventionnellement convertie en code, c’est la morale sociale – qui se différencie toutefois de l’éthique.
On peut toujours agir moralement sans souci du politique. Car l’éthique n’est rien d’autre que cet exercice de la liberté qui nous fait rationner notre désir, choisir non entre le « bien » et le « mal » mais très exactement entre un bien jugé moindre et un bien jugé meilleur. Et cela dépend d’une rationalité interne, laquelle n’a rien à voir avec le faux concept du « surmoi » imposé de l’extérieur par la famille, la société etc… Si jamais le politique introjecte les interdits, un surmoi, on se trouve dans un cas pathologique (névrose, par exemple). Cette rationalité se bloque chez le névrotique qui ne s’autorise rien, et n’a plus de frein chez le psychopathe condamné à rechercher une jouissance sans frein.
Mais on voit venir les barbiquets : « l’égoïsme », le manque de solidarité… bref, ils voudraient que la morale soit soumise à l’idéologie politique. Eh bien, si l’on a compris ce que je viens de dire, l’anachorète peut parfaitement se ficher du politique comme de sa première chaussette et être malgré tout très moral.
Maintenant, on peut aussi être « moral » en soumettant le ou la politique à un jugement de valeur : est-ce équitable ? Ou a un jugement éthique : est-ce légitime ? C’est ce qui se passe en ce moment, où la « légalité » socialiste est soumise au jugement de légitimité. Lorsque l’état politique ne nous satisfait pas, il est de valeur inéquitable et éthiquement illégitime. On peut tout aussi bien ne pas le juger et le subir. Bref : on peut être moral sans s’intéresser à la politique et faire de la politique tout en étant parfaitement immoral. Les exemples contemporains ne manquent pas !
Maintenant, « le travail permet-il de prendre conscience de soi » est un pont-aux-ânes. D’abord qu’est-ce-que la « conscience de soi ? Qui dit « conscience » dit « représentation ». Mais de quoi ? Et quel type de représentation ? Nous avons « gestaltiquement » représentation de notre corps (voir par exemple la proprio perception), de son environnement, bref, de notre soma. Et puis il y a le fameux « moi », dont nous savons depuis Freud et surtout Lacan qu’il n’est qu’une chimère. Je suis « moi », c’est-à-dire quoi ? Rien d’autre qu’un ensemble de représentations mythiques, le double-fond de l’être nous étant caché. Le cogito du père Descartes ne règle en rien la question, comme l’ont bien montré Berkeley et (à l’inverse du but recherché) la Phénoménologie d’Husserl.
Maintenant, le travail, c’est-à-dire cette analyse technique de production de l’outil. Admettons que l’on puisse alors se sentir homo faber, ça ne va pas très loin. Où l’on pourrait, à la rigueur, prendre « conscience » de devenir ce que l’on est (pas de coquille ici), c’est non pas en se disant adroit ou maladroit, sachant faire ou non-sachant faire, mais en remarquant que l’on met sa « griffe » sur ce que l’on produit : c’est très exactement ce qu’il convient d’appeler le style, qui est la marque propre de la Personne. On constate alors que l’on n’est pas « l’autre », c’est une épreuve négative de frontières, mais il ne s’ensuit rien de positif quant à un impossible « connais-toi toi-même ».
L’activité technique de production en soi n’est pas le métier, c’est-à-dire cette capacité sociologique d’œuvrer pour autrui. Ce n’est qu’en rapportant notre activité à ce que l’autre peut faire de ce que nous produisons que nous entrons dans une autre rationalité, non plus celle de la représentation, mais bien celle du social et de la communication… Par laquelle j’ai commencé l’épreuve !
Sacha
Share
 Chez Books on Demand (BoD)
Chez Books on Demand (BoD)

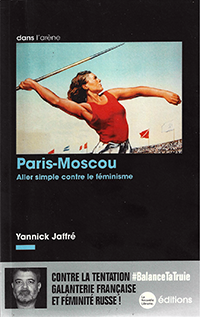 Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.
Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.


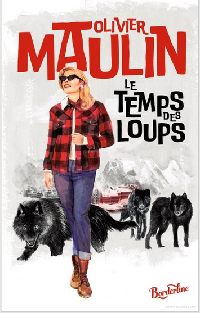 Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
 Très instructif. À méditer !
Très instructif. À méditer ! D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !
D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !



 Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !
Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !






 Bon ! À vos portefeuilles !
Bon ! À vos portefeuilles !





 ASSEZ DE BARBARIE !!!
ASSEZ DE BARBARIE !!!

 et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !
et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !