 L’an déferle sa morosité et ses colères cachées. Un cortège de hausses et de mesures électoralistes, comme d’habitude, vient abonder encore la grisaille d’une société au bout de sa décadence. Car tout le monde sait, en appelant de ses vœux illégitimes le Père-État rémunérateur et grand dispensateur d’irresponsabilité, que la partie est jouée, et qu’à moins de changer radicalement d’horizon, ce que la plupart refusent, le train social n’ira plus jamais comme avant. Il faut risquer ou périr, tout le reste n’est que propagande. Mais la responsabilité du citoyen est un exercice auquel peu, trop peu d’entre nous sont prêts.
L’an déferle sa morosité et ses colères cachées. Un cortège de hausses et de mesures électoralistes, comme d’habitude, vient abonder encore la grisaille d’une société au bout de sa décadence. Car tout le monde sait, en appelant de ses vœux illégitimes le Père-État rémunérateur et grand dispensateur d’irresponsabilité, que la partie est jouée, et qu’à moins de changer radicalement d’horizon, ce que la plupart refusent, le train social n’ira plus jamais comme avant. Il faut risquer ou périr, tout le reste n’est que propagande. Mais la responsabilité du citoyen est un exercice auquel peu, trop peu d’entre nous sont prêts.
Je relis une fois de plus Tocqueville, dans l’édition Robert Laffont, collection Bouquins, parue en 1986. Ce n’est pas, comme l’écrivent certains imbécile, « revisiter Tocqueville », car si ses écrits sont un monument, ce n’est pas un immeuble ni un paradis tarifié pour touristes. Au fil des années, j’y ai semé des dizaines de signets là où le crayon a souligné des passages témoignant d’une subtilité d’analyse, d’une capacité de déduction logique, pouvant passer pour prescience de notre temps, extraordinaires. En voici quelques morceaux choisis, qui, ce me semble, illustrent parfaitement la déplorable situation que nous connaissons aujourd’hui.
Il y est dit que si nous en sommes là, c’est notre faute. Tocqueville avait parfaitement saisi ce processus que j’appelle délégation, délégation d’un pouvoir dont nous sommes nous-mêmes au principe, du reste repris par la Déclaration de 1789. Bourbon, Bonaparte ou République, voire Ivan le Terrible, Staline ou Hitler, c’est toujours de délégation qu’il s’agit, tant que personne ne prend les armes : « car le principe de la souveraineté du peuple réside au fond de tous les gouvernements, quoi qu’on en dise, et se cache sous les institutions les moins libres » (Souvenirs, p. 208).
Cette tendance culturelle à la délégation du pouvoir, si elle ne s’entoure pas de précautions institutionnelles, c’est-à-dire de contre-pouvoirs, débouche presque automatiquement sur ce que j’ai appelé « fascisme », c’est-à-dire l’accaparement du pouvoir par une oligarchie voire, à l’extrême, par un seul ; on considère alors « cette masse confuse reconnue comme le seul souverain légitime, mais soigneusement privée de toutes les facultés qui pourraient lui permettre de diriger elle-même son gouvernement. Au-dessus d’elle, un mandataire unique, chargé de tout faire sans la consulter. Pour contrôler celui-ci, une raison publique sans organes ; pour l’arrêter, des révolutions et non des lois ; en droit, un agent subordonné ; en fait, un maître. » (L’Ancien Régime et la Révolution, p. 1014.
Rien d’étonnant, alors, qu’un pouvoir puisse faire fi de la volonté populaire, exprimée par des manifestations publiques massives (loi sur le « mariage pour tous ») ou même par référendum (2005 puis traité de Lisbonne). En contrepartie s’instaure une superstructure omnipotente, appelée « État », qui vise à perpétuer la mainmise de la minorité oligarchique sur le peuple, et pour la raison suivante : « quand le peuple commence lui-même à réfléchir sur sa position, il lui naît une foule de besoins qu’il n’avait pas ressentis d’abord, et que l’on ne peut satisfaire qu’en recourant aux ressources de l’État. » (De la Démocratie en Amérique, p 209).
Cet État s’enracine très profond dans l’Histoire. Je date l’origine du mal du règne de Philippe IV (« Philippe Le Bel »), et au fil du temps l’État, ajoutant à ses trois rôles régaliens de celui d’acheteur de la paix civile, s’est employé à lever de plus en plus d’impôts. Sous Henri III, au XVIe siècle, le travail est considéré comme un privilège et le droit de travailler s’achète. De nos jours, ce sont les charges et patentes, impôts sur le chiffre d’affaires et les plus values. Mais cela va bien plus loin. Sous Louis XIV, les terres du royaume sont considérées comme propriété de l’État, celui-ci devenant « le propriétaire véritable, tandis que les autres n’étaient que des possesseurs dont le titre restait contestable et le droit imparfait. (…)C’est l’idée mère du socialisme moderne. Il est curieux de lui voir d’abord prendre racine dans le despotisme royal. » (L’Ancien Régime et la Révolution, p. 1065). L’État devient donc par principe spoliateur. Il n’est donc pas étonnant que « l’ancien régime a fourni à la Révolution plusieurs de ses formes ; celle-ci n’y a joint que l’atrocité de son génie. » (ibidem, p. 1067).
Mais l’État omnipotent ne saurait tenir sans une caste de fonctionnaires, chargée par divers moyens de tenir le peuple dans les fers : « pour mettre le peuple dans l’obéissance et l’y tenir, moins vaut une législation atroce qu’on suit mal, que des lois douces qu’une administration perfectionnée applique régulièrement comme d’elle-même, tous les jours et à tous. » (L’Ancien Régime et la Révolution, p. 1109). Cette caste vit de l’impôt, et elle distribue des prébendes à d’autres qui vivent ipso facto de l’impôt (voir le nombre d’assistés de nos jours) : « la vérité est, vérité déplorable, que le goût des fonctions publiques et le désir de vivre de l’impôt ne sont point chez nous une maladie particulière à un parti, c’est la grande et permanente infirmité de la nation elle-même. » (Souvenirs, p. 744). Il s’opère donc une déresponsabilisation des citoyens, une perte absolue de l’esprit d’entreprendre et de courir des risques. Nous en voyons les effets pernicieux de nos jours.
Cette masse de prébendiers explique la dépense d’État comme le refus des gouvernements successifs que nous avons connus de la réduire. La guerre, certes, a historiquement contribué occasionnellement à augmenter la dette publique, mais comment expliquer qu’en soixante-dix ans de paix elle ait pris des proportions hors normes ? Comment expliquer que le système des impôts et des taxations soit devenu un maquis inextricable ? « Si vous rencontrez quelque ancien établissement du moyen âge qui se soit maintenu en aggravant ses vices au rebours de l’esprit des temps, ou quelque nouveauté pernicieuse, creusez jusqu’à la racine du mal : vous y trouverez un expédient financier qui s’est transformé en institution. Pour payer les dettes d’un jour, vous verrez fonder de nouveaux pouvoirs qui vont durer des siècles. » (L’Ancien Régime et la Révolution, p. 1014).
Ainsi va le cours des choses, du temps de Tocqueville comme du nôtre. Nous souffrons de l’État et de la confiscation de notre pouvoir : « les grandes richesses et les profondes misères, les métropoles, la dépravation des mœurs, l’égoïsme individuel, la complication des intérêts, sont autant de périls qui naissent presque toujours de la grandeur de l’État. » Or cela ne peut être changé par le jeu ordinaire des institutions -puisqu’il n’y a pas de contre-pouvoirs – ni surtout des partis où « l’intérêt particulier, qui joue le plus grand rôle dans les passions politiques, se cache ici plus habilement sous le voile de l’intérêt public. » (De la Démocratie en Amérique, p. 119). Les prétendants à la délégation suprême, comme chez nous les candidats à la présidence de la République, ne constituent pas une classe de gens « bien nés », maîtres d’eux-mêmes et de leurs désirs, et donc capables de veiller à modérer les nôtres ; tout au contraire, « ce qui est bien certain, c’est qu’en France, tous les chefs de partis que j’ai rencontrés de mon temps [et du nôtre, donc !] m’ont paru à peu près indignes de commander, les uns par leur défaut de caractère ou de vraies lumières, la plupart par leur défaut de vertu quelconque. » (Souvenirs, p. 774). On ne saurait mieux décrire les personnages figurant au catalogue politique contemporain.
Pire encore, le potentat parvenu est toujours mieux placé pour perpétuer son pouvoir que les impétrants à s’en emparer : « quand un simple candidat veut parvenir par l’intrigue, ses manœuvres ne sauraient s’exercer que sur un espace circonscrit. Lorsque, au contraire, le chef de l’État lui-même se met sur les rangs, il emprunte pour son propre usage la force du gouvernement. Dans le premier cas, c’est un homme avec ses faibles moyens ; dans le second, c’est l’État lui-même, avec ses immenses ressources, qui intrigue et qui corrompt. » (De la Démocratie en Amérique, p. 147). Nous devrons nous en souvenir en 2017.
Nous voilà donc pris dans une situation sans autre issue que la révolution, et non les lois, car « quand les citoyens sont tous à peu près égaux, il leur devient difficile de défendre leur indépendance contre les agressions du pouvoir. Aucun d’entre eux n’étant assez fort pour lutter seul avec avantage, il n’y a que la combinaison des forces de tous qui puisse garantir la liberté. » (De la Démocratie en Amérique, p.81). En sommes-nous capable, de recouvrer cette autonomie que Tocqueville nomme « liberté » ? J’en doute fort, car « ce que haïssent les peuples faits pour être libres, c’est le mal même de la dépendance. » (L’Ancien Régime et la Révolution, p.1053). Or, nation de cotisants, contribuables et allocataires, on dirait que les Français chérissent au contraire cette dépendance qui leur donne une fausse impression de sécurité – aujourd’hui bien battue en brèche par la conjoncture désastreuse – en les rendant irresponsables et incapables d’entreprendre. Bref : en en faisant des sous-hommes. Ceux qui réclament des libertés perverses, et ils sont légion, ces chiens de garde de la pensée unique, ne recherchent pas l’autonomie, la liberté, car l’autonomie ce n’est pas d’assouvir les appétits dont on est esclave : « qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est fait pour servir. » (ibidem).
Au fond, nous touchons au terme d’une dégradation commencée il y a des siècles, accélérée par la Révolution, les Empires et les Républiques successives. Les derniers ajustements constitutionnels ont parachevé l’œuvre de destruction. D’aucuns espèrent un désaveu du pouvoir lors des élections municipales. Certes, « les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science » (De la Démocratie en Amérique, p.85), mais les accapareurs du pouvoir ont pris soin de les vider de toute possibilité d’action démocratique : « or ôtez la force et l’indépendance de la commune, vous n’y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. » (De la Démocratie en Amérique, p.91)
La voix de Tocqueville résonne dans le désert et ne rencontre plus guère d’échos. Bientôt elle se taira, faute de citoyens. Ce peuple est mûr, désormais, pour l’esclavage sous la férule des barbares. Je me réjouis d’être vieux, je ne verrai pas, j’espère, les effets de cet asservissement, et j’approuve les jeunes gens qui vont trouver autonomie et responsabilité sous d’autres cieux.
Sacha.
Share
 Chez Books on Demand (BoD)
Chez Books on Demand (BoD)

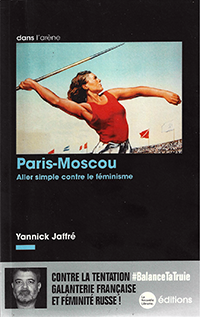 Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.
Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.


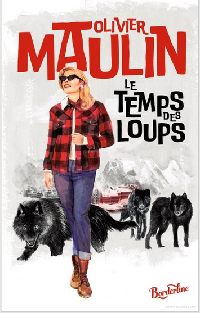 Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
 Très instructif. À méditer !
Très instructif. À méditer ! D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !
D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !



 Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !
Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !






 Bon ! À vos portefeuilles !
Bon ! À vos portefeuilles !





 ASSEZ DE BARBARIE !!!
ASSEZ DE BARBARIE !!!

 et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !
et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !