 2732. Les troupes de Charles XI Martel infligèrent près de Poitiers une défaite décisive mettant fin au califat résiduel d’Abd Al Rahman et à l’asservissement sept siècles durant de la France à l’islam. Un vieux chroniqueur dominicain, Imprecator, raconte l’effondrement du pays soixante-dix décennies auparavant. (Texte long !)
2732. Les troupes de Charles XI Martel infligèrent près de Poitiers une défaite décisive mettant fin au califat résiduel d’Abd Al Rahman et à l’asservissement sept siècles durant de la France à l’islam. Un vieux chroniqueur dominicain, Imprecator, raconte l’effondrement du pays soixante-dix décennies auparavant. (Texte long !)
Une époque de troubles terribles ! D’horribles spectacles ! Des meurtres et fourberies subtiles ! Puis-je donner de ces temps une description fidèle ? Quelque précise qu’elle sera, la chronique manquera à relater l’exacte déréliction d’une civilisation s’affaissant dans le fracas de l’effondrement des temples.
Un monarque n’était arrivé-là qu’au prix de tromperies, de fausses promesses relayées par des crieurs publics stipendiés des forces obscures gouvernant alors la planète. Prompts furent à le rallier tous ceux dont l’unique souci était de paraître et de s’enrichir, et Dieu sait s’ils furent nombreux ! Ils étaient déjà convertis à toutes les turpitudes habitant les esprits égarés de quelques déments illettrés prêchant l’hédonisme du chaos, la haine de soi et de sa race, l’adoration du barbare, la perversion des mœurs. Aussi n’était-il point trop hardi pour ces misérables de s’enrôler sous la bannière de ce souverain de comédie ; ils en partageaient la doctrine et cuidaient en partager la rapine.
Au vrai, l’usurpateur n’était guère plus qu’un satrape, les maîtres véritables étaient ailleurs, habitants sans racines d’un espace fluctuant, grands larrons devant l’Éternel, dispensateurs de monnaie de singe dont ils faisaient usage pour accroître leur prospérité et leur pouvoir. L’Allemand avait pris l’Europe et, fourbe assisté de valets serviles, imposait sa loi sous des dehors faussement bénins. On le savait désormais, le roi s’était laissé persuader d’initier des traités inégaux, livrant à l’étranger les lois, les richesses et les armes de son pays. C’est haute trahison !
Il convient de le dire, le podestat claquemuré en son palais de l’Élysée, pour quadragénaire qu’il fût, n’était qu’un enfant. Væ tibi terra cujus rex puer est ! Car ce corps d’homme fait n’était point habité de l’esprit sage des véritables serviteurs du peuple, il l’était d’une âme immature, inconséquente et inconvenante de l’infans auquel nul précepteur n’aurait appris à se conduire par voie de logique et de raison. Aussi ce puéril souverain prêchait-il tout et son contraire, agissait au rebours de ses dires, énonçait au contraire de ses actes. La chronique raconte que tel fut le fond de sa harangue devant les chefs des Armées.
Somme que ce faussement nommé Emmanuel représentait tragiquement l’air du temps. Les moissons pouvaient avoir été bonnes, les prix pourtant ne cessaient de monter, hors de porté des pauvres qui étaient accourus en foule sur les grand-routes puis, pour leur malheur, dans les villes où la piétaille du podestat les mutila et les livra aux juges.
L’on avait ouvert les portes du pays et des cités à des hordes barbares venus des confins d’un continent déshérité de toute raison. Un chroniqueur de ces temps attestait avoir contemplé les campements de ces nomades sans feu ni lieu proliférant au cœur même de la capitale. D’autres s’emparèrent du ban des villes. Alors, sous les exhortations de prédicanteraux semant dans les esprits tors la loi criminelle inspirée d’un chamelier pillard et meurtries, ils subvertirent ces lieux. Les dépouilles des anciens rois, sises en la basilique édifiée par Suger, reposèrent désormais en terre ennemie. Le guet lui-même n’osait s’aventurer en ces rues d’embuscades et l’on craignait que quelque jour ces meutes fanatiques ne se précipitassent à l’assaut des quartiers bourgeois. Aussi agissait-on envers ces gueux avec une coupable mansuétude. On fit montre de les protéger, on réinstitua le péché de blasphème contre leur seule croyance, on feignit de croire que la détestation des simagrées mahométanes constituait une insulte à leur race. Pis, l’on fit de quelques-uns des clercs auprès des Chancelleries de l’État. Nonobstant, nombre de citoyens périrent de la main de ces adeptes du Vieux de la Montagne, par la poudre ou le couteau. Ils proclamèrent des édits meurtriers contre qui osait les contredire. Le plus souvent ces crimes furent celés par les puissants et leurs sbires, de crainte que le peuple n’exerçât à leur encontre quelque juste vindicte. Peu à peu, profitant de la lâcheté des édiles, ils subvertirent le pays. Vol, viol et meurtre devinrent maîtres de la société. Plus rien n’était sûr dès qu’il n’y eut plus de bien commun ni d’État.
Le chroniqueur peine à saisir d’où jaillit l’impetus ayant mis en branle ce désastre. Je le soupçonne de résider dans la décadence générale des mœurs. Non que tous en fussent frappés car il demeurait encore dans les campagnes des gens ayant bon-sens rassis. Toutefois la peste de l’esprit fit des ravages dans certaines castes urbaines, parmi les hédonistes frénétiques, déracinés, jouisseurs sans entraves, contemplateurs de leur omphalos, souvent quasi illettrés mais se croyant savants, prêchant une fausse morale, s’instituant très illégitimement arbitres des élégances et de la correction.
Il serait bien présomptueux de prétendre détailler le Catalogue de cette Cour des Miracles, toutefois je puis en indiquer quelques parangons. Ces personnages ineptes avaient l’oreille des puissants et des crieurs publics, en vertu de quoi ils obtinrent des Communes au sein desquelles ils étaient très représentés l’instauration de moult lois néfastes, pro domo et ad hominem. De tels édits ne pouvaient que distendre jusqu’à craquer la trame de la société. Il en fut ainsi. Car, sicut dixit Aristoteles, Politique, V, « les passionnés d’égalité provoquent des séditions s’ils croient avoir trop peu alors qu’ils sont égaux de ceux qui ont davantage ; les passionnés de l’inégalité et de la prééminence font de même s’ils supposent que, bien qu’inégaux, ils n’ont pas plus mais autant ou même moins. »
Ibi jacet lepus, ce me semble. Deux ou trois siècles auparavant survint une fort malencontreuse révolution. Les séditieux étaient bourgeois enrichis par leur commerce et leur industrie. Certains avaient acheté des charges, quelques-uns même furent Chanceliers. N’ayant cependant pas l’entier pouvoir, ils renversèrent l’ordre du royaume et s’en emparèrent. Travestissant leur sédition en ordre moral, ils érigèrent en dogme, mais non en droit, une délirante pétition de principes qu’ils nommèrent « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » en foi de laquelle, clamaient-ils, « les hommes naissent et vivent libres et égaux en droits et en devoirs. » Au fil des siècles, cela devint une arme contre les peuples. Aux temps dont je parle, le dogme subvertit les consciences de certains esprits faibles qui le convertirent en droit. « Nemo auditur propiam turpitudinem allegans », énonçait le droit Romain. On biaisa. Il suffit de libérer la turpitude et la perversion de la culpabilité pour qu’elles fussent alléguées ! Lors, se réclamant des droits de l’homme, les turpides considérèrent que le droit leur donnait trop peu en regard de la loi commune. Adoncques au nom de l’égalité ils revendiquèrent des droits spécifiques en faveur des minorités, instituant par là-même une paradoxale inégalité devant la loi commune, id est des privilèges. Voilà une des causes, ce me semble, de l’anéantissement de la société, car devenus privilégiés, les déviants eurent à cœur d’étendre leurs privilèges indus, au prix d’un asservissement de la majorité du corps social.
En ces temps-là rares furent les bons esprits à décrier telle outrecuidance. On les fit taire par la force de lois de circonstance. De petits esprits s’employèrent en même temps à pervertir le concept de Nature. Pour ce que, soutenaient-ils, Nature crée des différences. Il fut trop vite admis que les différences naturelles constituaient des inégalités. Voilà qui était, certes, spécieux et plein de fausseté, mais les gens étant de moins en moins instruits, cet aphorisme fut admis sans plus d’examen. La Nature, disait-on, n’est pas conforme aux droits de l’homme. Par engin de sophismes, on décréta donc que Nature n’avait nulle prérogative et que tout dépendait en somme de la décision personnelle de l’individu concerné. Exempli gratia, « on ne naît pas femme », pérorait une bourgeoise désœuvrée et perverse, « on le devient ». Ainsi, par singulière loxodoxie, l’on vit des esprits délirants battre la campagne et instituer en Sorbonne et ailleurs des disputes byzantines à propos du genre. Quelques ans avant la chute, l’on vit le provignement des genres, quelques fols prétendant même en changer aux matines et à vêpres sonnantes !
Tout se tient, dans la Nature idem en la société, comme les maillons d’une chaîne. L’on fit des lois permettant aux pervers de contracter alliance. Toutefois, Nature ne leur accordant pas de procréer selon ses lois cosmiques, l’on décida de recourir aux artifices des mires. On allait inséminer les filles de Gomorrhe et louer à prix fort les entrailles des femmes pauvres afin que les adeptes de Sodome fussent en veine d’enfants. Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. Il était légitime que tout citoyen ayant conservé bon-sens et quelque peu de morale protestât contre cet hubris scandaleux. L’on fit taire les mécontents, on les mit à l’amende, on les emprisonna. N’est-il pourtant pas porter atteinte à l’ordre du monde que de faire naître des enfants sans père, ou de consommer philtres et potions, voire recourir au bistouri pour tenter ridiculement de mettre en conformité son sexe naturel avec son genre fantasmé ?
Mesmement vit-on se constituer des hétairies de femelles travaillées d’hysteria décrétant que Dame Nature avait grand tort d’avoir voulu qu’il existât deux sexes complémentaires, que c’était injustice et qu’en conséquence telle discrimination devait être abrogée. Ces bacchantes aussi laides de corps que d’esprit s’insurgèrent contre les mâles, alléguant qu’iceux les dominaient d’un insupportable patriarcat. Certes, ce n’était-là en grande partie que fariboles, toutefois ces harpies s’ingénièrent à infliger aux mâles le supplice d’Abélard, au moins par instillation de sophismes lorsque ce n’était pas par engin de coutellerie. L’on vit donc surgir des ribambelles de revendications propres à instaurer un matriarcat plaçant les hommes au giron. Peu courageuses, dépourvues de sagesse et d’esprit critique, les fausses élites au service des puissants s’empressèrent de créer de nouveaux privilèges afin de satisfaire non point la grande majorité des femmes qui ne demandait rien, mais uniquement celles dépourvues de raison et criaillant telles des damnées. L’on instilla à force dans les cervelles juvéniles de tels faux principes qu’une politesse, une petite galanterie, un regard enamouré devinrent ipso facto un crime de lèse-virago.
S’étonnera-t-on que soumis à telle décérébration les jouvenceaux fussent devenus chapons ? Les bacchantes de ces temps avaient réussi à instituer l’état de guerre entre les deux sexes. La virilité, l’amour disparurent au profit de la veulerie et de l’obscénité. Disparaissait également la famille par l’action des pervers et autres adeptes du genre et de la bacchanale. On fit pire, car en dehors de toute morale humaine, l’on autorisa et même encouragea le meurtre au commencement et à la fin de la vie. À d’irraisonnables et fort condamnables prétextes de confort, de futures mères eurent licence de tuer le fruit de leurs entrailles en l’extirpant de leur sein. À l’autre bout de l’existence, on s’autorisa à faire périr de malemort malades et vieillards avant la fin naturelle de leur vie. La société était devenue un chaos de perversion, de turpitudes et de crimes. Peu, trop peu nombreux furent encore ceux qui avaient conservé des principes moraux pour guider leur vie, du reste on les punissait de leur rectitude.
Les esprits pervers de ce pandémonium soûlaient à s’assembler en petits cénacles. Infiniment clairsemés dans la population, ils menaient cependant grand tapage, amplifié à l’excès par les crieurs publics, de sorte que le peuple fût contraint d’y prêter l’oreille et sommé de se soumettre à leurs folles doctrines. Toutefois leur union n’était que de façade et l’on sait que ces chapelles maudites s’excommuniaient férocement les unes les autres. Leur hypocrisie honteuse ne manquait jamais d’éclater au jour chaque fois que l’un ou l’autre parmi leurs coteries était victime d’agressions ou de menaces de la part des barbares invasifs. Alors, tous ou bien se taisaient en regardant ailleurs, ou bien minimisaient le crime, ou bien finissaient par concocter quelque excuse en faveur des agresseurs. Cette abominable conduite s’explique par recours à un curieux principe, fort spécieux, prétendant que l’on ne saurait stigmatiser une communauté déjà stigmatisée -à leur dire !- sous prétexte de malfaisance patente Ils nommaient ce sophisme « intersectionnalité » des « luttes ». On ne trouverait nulle part pareille loxophrénie sur la planète, dût-on recenser cent-mille ans d’histoire !
Parlant de cette distorsion maladive de l’esprit que j’ose nommer loxophrénie, il convient de flétrir un paradoxe selon lequel la Nature, vilipendée pour son injustice supposée, devenait nonobstant l’objet d’une douteuse affection de la part de certains sectaires qui se nommaient eux-mêmes « écologistes ». On comptait ceux-là parmi les sociétaires des cénacles susmentionnés, toutefois leur nombre excédait largement les piteux effectifs de ces hétairies. Au vrai, ces énergumènes urbains n’avaient nulle connaissance de Nature, ni par les livres car la majorité d’entre eux étaient incultes, ni par l’expérience car ils évitaient tout commerce avec ceux qui travaillent avec la Nature, hommes de la glèbe, culs-terreux labourant et élevant les viandes qu’eux eussent répugné à traiter avant de les trouver, aseptisées, dans leurs assiettes. En somme, ces adeptes de la Nature vivaient une fantasmagorie, un mythe qu’ils appelaient quelquefois Nature, plus souvent Planète. Or l’on observa que Gaïa était sujette à variations, tantôt glaciales, tantôt torrides, selon une périodicité connue des véritables savants et devant tout à l’ordre du Cosmos. Ils se mirent donc en tête que les humains, par leurs activités, étaient coupables d’un réchauffement planétaire. Ils décrétèrent polluant le malheureux gaz carbonique pourtant si utile à la flore.
Survint une prêtresse folle qui fit descendre dans les rues des villes des foules de flagellants encaponnés, de prédicateurs fanatiques accusant les peuples d’être coupables du crime de réchauffement, terrorisant les naïfs par leur prédiction du Déluge. La Pythonisse à tresses trouva des boucs-émissaires, les « Blancs paternalistes et colonialistes », et invectiva les hommes de pouvoir, leur commandant des actes en tous points contraires à l’intérêt des populations. On l’écouta ! S’ensuivirent des mesures vexatoires telles des impositions insupportables, le remplacement des coches à moment thermique par d’autres à moment électrique infiniment plus polluants dès la fabrication. Le peuple souffrit en vain, car tout ce tabois n’était que délirantes fariboles d’esprits dérangés, ne profitant qu’à la carpaudaille des filous vendeurs de rogatons et de vent. Pis, l’appauvrissement consécutif mit en danger l’espèce humaine sommée de ne plus produire ou au moins de moins produire mais à prix prohibitif au prétexte de sauver la Planète ! Les esprits les plus malades en virent jusqu’à prohiber l’enfantement sans toutefois étendre cette défense aux pervers et aux fertiles barbares.
Adoncques les temps dont je parle furent étonnamment pervertis, la civilisation déclina comme l’âge fait décliner la personne : claudicat ingenium, delirat lingua, labat mens. Ce furent temps de grande traîtrise, de grande fourberie, de grande perversion, de grande corruption, de grand désordre, un chaos.
Le pays attendait ! On avait perçu moult signes et présages. Des pestes surgissaient en quelque point de la Terre, que propageaient les commerces absurdes entre pays du monde. Les puissants fabriquaient de la fausse monnaie afin de rémunérer leurs activités spéculaires improductives en biens. L’on savait proche l’éclatement de la finance. Le podestat ne prêtait nulle attention aux souffrances du peuple et aimait s’entourer d’une cour de pape-geais sans autre savoir-faire que celui de paraître. La colère grondait, on haïssait le prince. Hélas nul rédempteur ne paraissait au zénith, aucun Messie ne s’annonçait, nul ne cuidait rassembler le peuple pour qu’il prît son devenir en mains, aucun parti n’emportait les suffrages tant ils étaient tous pétris des délires ambiants et craignaient les accusateurs publics, même ceux-là de ces partis dont il eût été légitime d’attendre un élan salvateur.
Temps sordides ! Temps détestables de corruption, de perversion, de déraison ! Temps maudits.
Alors tout s’effondra, puis le barbare qui campait dans la Cité s’empara du pouvoir. Commencèrent sept siècles de plomb.
L’imprécateur.
NdlR : Quiconque verrait dans cet écrit une description apocalyptique de notre France où tout va bien se tromperait grossièrement !
Share
 Chez Books on Demand (BoD)
Chez Books on Demand (BoD)

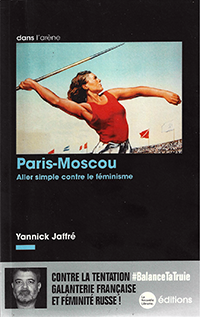 Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.
Excellente approche anthropologique de l'immense différence entre les femmes Russes et les horreurs quérulentes à cheveux bleus de chez nous.


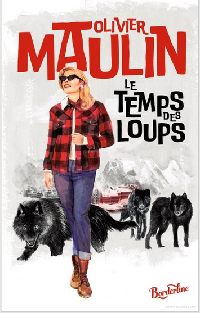 Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
Livre truculent, dont il faut retirer " la substantifique mœlle". Lorsque tout fout le camp, que faire ?
À lire pour rire et réfléchir !
 Très instructif. À méditer !
Très instructif. À méditer ! D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !
D'où viennent-ils ? Qu'ont-ils vu ? Quel est le combat ?
Pensée et testostérone !



 Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !
Insigne des Masques Jaunes :
adoptez-le, portez-le !






 Bon ! À vos portefeuilles !
Bon ! À vos portefeuilles !





 ASSEZ DE BARBARIE !!!
ASSEZ DE BARBARIE !!!

 et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !
et toutes les formes de fascisme dont le socialisme.
Notre "antikons" a le droit d'aînesse :)
Que de tels mouvements naissent chez nous et dans toute l'Europe !